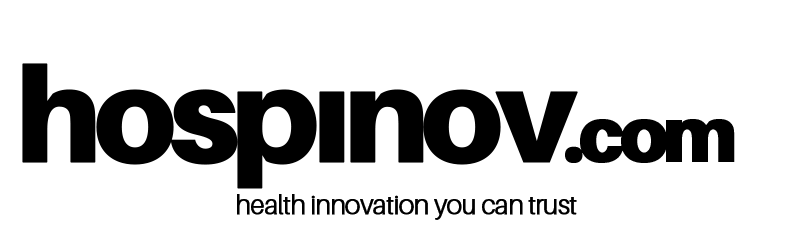Co-écrit avec Stéphane Le Bouler, secrétaire Général du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, cet article présente quelques-unes des problématiques clés de l’ouvrage « Etudes de santé : le temps des réformes ».
La réforme des organisations de santé est en permanence à l’agenda des pouvoirs publics mais ce n’est pas seulement un sujet budgétaire ou un sujet de spécialistes. Cette réforme nécessite de s’intéresser à la formation des médecins et autres professionnels de santé tant celle-ci emporte de conséquences en termes de qualité de la prise en charge, de relations médecins-malades, de couverture des besoins de la population au plan territorial mais aussi de performance de la recherche et de capacités d’innovation (thérapeutique, technologique, organisationnelle).
Les dépenses de santé sont, pour une large part, des dépenses de personnel ou des dépenses prescrites par les soignants : la formation de ceux-ci, leur capacité à coopérer et à se coordonner, les échanges d’informations mais aussi les représentations que se font les usagers sont des variables essentielles.
Réciproquement, les formations doivent en permanence se renouveler pour prendre en compte et diffuser, en formation initiale et en cours de carrière, les innovations en termes de prises en charge et d’organisation.
De nouveaux défis
La pandémie de Covid-19 a fait ressurgir, et avec force, la thématique des maladies infectieuses. Cela ne doit pas occulter une tendance de fond : la part de mortalité liée à ces maladies a été globalement réduite au cours des dernières décennies dans les pays industrialisés. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité, mais le risque de mortalité aiguë au moment d’un événement a diminué, conduisant à augmenter le nombre de personnes souffrant des conséquences chroniques de ces maladies (insuffisance cardiaque, déficits neurologiques, etc.).
À lire aussi : Les maladies chroniques sont sous-estimées : comment mieux les prendre en charge ?
Par ailleurs, les progrès thérapeutiques ont permis d’augmenter la survie des patients atteints de cancer. Enfin, la transition démographique (augmentation de la longévité et diminution de la fécondité) aboutit à un vieillissement de la population. Ainsi, le système de santé est de plus en plus confronté aux maladies chroniques et aux conséquences du grand âge (dépendance), impliquant de renforcer l’accompagnement et la personnalisation des réponses.
Le caractère interprofessionnel du travail doit faire partie intégrante de la formation universitaire dans la mesure où un certain nombre de situations font intervenir de nombreux acteurs (issus des champs sanitaire, médico-social, social et de l’entourage de la personne) afin de construire la meilleure réponse individualisée coordonnée (rapport ONDPS 2019).
Une question à l’agenda
Si l’organisation du système de santé surgit de temps à autre dans l’actualité, la question de la formation des professionnels reste peu médiatisée, volontiers laissée aux acteurs de la formation : les facultés de médecine, de pharmacie ou d’odontologie, longtemps davantage identifiées ici que les universités auxquelles elles appartiennent ou les institutions de la formation paramédicale, en particulier les anciennes « écoles d’infirmières », connues dans le grand public.
Pourtant, les réformes en matière de formations de santé sont très régulièrement à l’agenda des pouvoirs publics. Elles y sont même en permanence ces dernières années mais, la plupart du temps, dans un registre technique, avec une forme de délégation aux corps spécialisés de formateurs, au premier chef les doyens et les professeurs de médecine au sein des facultés.
On objectera qu’on a un peu parlé de la suppression du numerus clausus de médecine sur les estrades des campagnes électorales et dans les médias. Présence très fugace cependant, et ambivalente puisqu’on supprime le numerus clausus national tout en en confiant la régulation aux universités. De cette réalité de la réforme, et du fait qu’elle ne produirait des effets que dans dix ans, il ne fut guère question. La suppression du numerus clausus a d’ailleurs occulté l’autre volet – plus crucial encore – de la réforme : la diversification de l’accès aux études médicales et pharmaceutiques ainsi que la possibilité offerte aux reçus-collés (c’est-à-dire les étudiants ayant eu de bons résultats sans figurer parmi les candidats sélectionnés) de poursuivre une formation sans repartir à zéro.
 On supprime le numerus clausus national tout en en confiant la régulation aux universités. Shutterstock
On supprime le numerus clausus national tout en en confiant la régulation aux universités. Shutterstock
Les décisions publiques en matière de formation engagent le temps long. Cela est vrai des réformes elles-mêmes, qu’il s’agisse de l’enseignement scolaire (que l’on songe aux débats sur le « collège unique » ou aux transformations du lycée ou du baccalauréat) ou de l’enseignement supérieur. Cela est vrai aussi des impacts et des conséquences de ces décisions. Les institutions de formation (normes, équipements, ressources humaines) se restructurent dans la durée. Les trajectoires professionnelles se construisent à long terme et ne s’infléchissent pas facilement.
Ces constats se vérifient particulièrement dans le champ de la santé, compte tenu de la durée des études médicales (celles qui structurent l’ensemble) mais aussi de l’intrication entre le système de formation et le système de santé.
Tout cela impose de prendre le temps de considérer les relations entre ces deux systèmes, pour comprendre leurs relations, mesurer les exigences du changement et, d’un point de vue opérationnel, la portée des stratégies de régulation et de planification.
Quelle régulation ? Quelle planification ?
Le système de départ, dont on s’éloigne progressivement, peut être assez simplement décrit :
-
une organisation des formations cloisonnée, hiérarchique et discontinue (médecins/autres professions, centres hospitaliers universitaires/autres hôpitaux, spécialistes de deuxième recours/généralistes, formations courtes/longues) ;
-
un régime statutaire dual (salarié/libéral) ;
-
des financements cloisonnés (ville/hôpital, actes/budget global, etc.) ;
-
une gouvernance distincte (régalienne/conventionnelle, État/assurance maladie, et au plan régional).
Les professions évoluent : la profession médicale est écartelée entre spécialisation de plus en plus poussée et préoccupation holiste, les rôles des spécialités de ville et de la spécialité de médecine générale semblent plus incertains, une forme de continuum se cherche entre les professions, etc.
Les outils de régulation quantitative des effectifs en formation (numerus clausus et quotas) peinent à suivre l’ouverture internationale – et, singulièrement, la libre circulation des professionnels au sein de l’espace européen – et à s’adapter aux aspirations des professionnels comme aux modifications de la demande sociale. De fait, les déséquilibres sont multiples (sur le territoire, par spécialité, au niveau des professions), les corrections brutales (cf. numerus clausus).
À lire aussi : Médecins scolaires, un rôle trop méconnu ?
Les outils de régulation en aval de la formation apparaissent quant à eux tardifs. De plus, ils sont ponctuels (au lieu de prendre en charge le parcours, de la formation à la stabilisation professionnelle), disjoints (la protection sociale est une variable clé de l’entrée dans la carrière, pas toujours prise en compte comme elle le devrait), cloisonnés (effectifs en ville/effectifs hospitaliers).
Pour être en mesure d’affronter les transformations à venir, un certain nombre d’exigences en matière de formation se font dès lors de plus en plus pressantes : une nouvelle approche de la régulation quantitative, un rôle privilégié pour l’Université, un travail sur les processus de spécialisation, l’adaptation des métiers à conduire dans le cadre du « virage ambulatoire », l’inter-professionnalité et la transversalité, une aspiration très forte à la mobilité, le développement d’une politique qualité et une régulation globale plus cohérente. Ce sont tous ces aspects qu’il faut prendre en compte pour mesurer la portée des réformes actuelles des formations de santé.